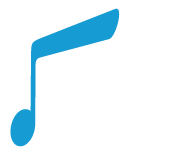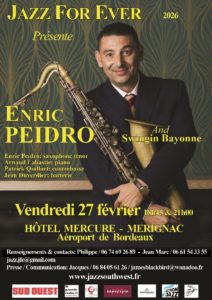par Philippe Alen
Écouter pour l’instant – Session 1. Bergerac, Queyssac et Monfaucon, 8-10 octobre 2020.
Cette année 2020 aura éprouvé bien des énergies, et des patiences. La plupart des festivals sont tombés comme des fruits pas mûrs. Peu d’entre eux ont été maintenus : urgence, résistance, inconscience ? Parmi ceux-là, Écouter pour l’instant, qui, contre vents et marées, persiste à présenter dans des villages perdus, au cœur d’une cité touristique qui ne semble pas mesurer la chance qu’elle a, des musiques qui donnent encore des raisons d’espérer.
Par ici, les non alignés… Quand de toutes parts la culture administrée jardine friches et jachères, vitrifie l’invention, épand l’académisme par traitement systémique, c’est à de tels rendez-vous qu’il faut se rendre pour recueillir de la musique un battement de cœur qui ne doit rien à son pacemaker.
Adieu, mes très belles…
Quand donc résonnent les premiers soupirs, doux et lents, de Poline Renou (vcl) – Ah… Ahh… Ehhh –, qu’ils se confondent avec un murmure de clarinette basse animée de la scansion sourde des mailloches, c’est de ce cœur même que provient, au travers des couches accumulées du temps, ce qu’a pu filtrer de traditions lointaines, en peuplant une mémoire collective dont nous ne sommes, savants ou ignorants, conscients ou non de cette sédimentation, que les éphémères dépositaires.

Dans les lignes sinueuses de Mathieu Donarier (cl, bcl), dans les peaux brossées, les chocs de bois ou de cuivre sous la main de Sylvain Lemêtre (perc), la fusion d’un aigu cristallin et d’une résonance de gong, ce sont des fastes médiévaux que réveillent, dans un présent troublant, le trio d’Adieu mes très belles. Le nom que se sont choisi les musiciens rend hommage à Gilles Binchois (v.1400-1460), mais le matériau de base dans lequel ils plongent emprunte aussi bien à un plain-chant plus ancien qu’au répertoire de chansons renaissant. Après avoir fouillé l’espace, en faisant s’interpénétrer des traditions que rien n’appelait a priori à se rencontrer – voire en les détroussant –, on explore volontiers aujourd’hui le temps, et singulièrement cet univers médiéval que le jazz, depuis les années soixante, a rapproché de nous en frayant les voies modales, d’une part, et celles de la spiritualité et du mysticisme de l’autre. (Il y eut même un temps où Hildegard von Bingen s’invita dans les charts, à la faveur d’une équivoque qui fit d’elle une lointaine ancêtre des musiques « planantes ».) Néanmoins, c’est bien loin de Coltrane que s’épanouit Adieu mes très belles.
Le duo qu’ont formé il y a déjà 14 ans Mathieu Donarier et Poline Renou, quand celle-ci chantait dans l’ensemble Huelgas – sans conteste le plus somptueux des ensembles vocaux de musique ancienne –, s’est récemment adjoint le concours d’un percussionniste rompu au répertoire contemporain, mais pour qui le gamelan balinais n’a pas plus de secrets que les paysages moyen-orientaux que fait lever le zarb. Cette dimension étend encore le champ de l’improvisation tout en resserrant les liens entretenus avec le passé médiéval et renaissant où la percussion était très présente. Les possibilités accrues, tant sur le plan rythmique que sur celui des timbres enrichit encore le travail sur les lignes que la formation initiale à deux mettait en avant. Extatique ou courtoise, la célébration de la beauté, toujours spirituelle, donnait à la musique, solidairement son objet et son sujet. Adieu mes très belles ne trahit pas cet enjeu, et il n’est pas interdit d’entendre en ce nom choisi une forme heureuse de nostalgie suscitée par la disparition d’un rapport immédiat, simple et direct à ce registre émotionnel.

Pour les trois concerts d’EPI, il a fallu négocier avec les acoustiques bien typées qu’offrent tour à tour le Temple protestant de Bergerac, la petite église très sonore de Queyssac et celle de Monfaucon, moins contraignante. Comme toujours pour ce festival à la forme unique, il était passionnant de suivre l’évolution de la musique en accord avec les lieux. À Queyssac, il fallut donner du temps au son, qu’il ne se brouille, espacer les entrées, jouer plus souvent deux à deux, en solo. La mesure prise du rôle actif des murs, Donarier usa par exemple de cycles d’arpèges nourris du retour du son. Peaux enveloppées, mailloches caressantes, voix pure, déplacements, positionnements évolutifs, tout concourut à l’éclosion d’ambiances véritablement liturgiques. Par la projection de la clarinette tournée vers le choeur, par la déambulation de la chanteuse, les musiciens tournèrent la situation à leur avantage, l’espace modelant la musique, la musique modelant le temps. Pour la chanson de Binchois, Adieu mes très belles [amours], les slaps crépitants de la clarinette inventaient une troisième main à Lemêtre qui, de son zarb, tirait des sons qui auraient pu venir d’elle.

À Monfaucon, dans une acoustique plus précise, cette même combinaison sonnait plus différenciée, comme le fondu des slaps glissés dans un jeu de zarb époustouflant. Sur cette même pièce les extrapolations vocales, onomatopées, souffles, emmenaient ailleurs. Gongs, cloches : la percussion se permit de céder davantage à l’impulsion, de recourir à un jeu plus nerveux et cependant très contrôlé dans des formes plus volontiers cycliques sans risque de confusion. Donarier recourut à des lignes plus abstraites, et pour finir la danse s’esquissa, pour les musiciens, comme le prolongement naturel de la posture. Pour une magnifique chanson de Claude Lejeune (v.1530-1600), la clarinette s’enroula autour de la voix au plus proche de la déclamation, puis, spectaculaire, la restitution libre d’un « hoquet » enflamma les percussions dans une feu d’artifice d’appels et d’interjections. Enfin, Donarier qui, dit-il, désirait jouer cette pièce depuis trois jours, provoqua malicieusement un rappel pour nous livrer enfin le Hodie puer nascitur tiré d’un manuscrit cypriote du XIVe s. Depuis longtemps déjà, comme Ornette Coleman l’avait prophétisé, cela dansait dans les têtes.
« Tout commence par la disparition »
La loi est dure, mais c’est la loi. Et celles de l’acoustique ne sont pas moins impitoyables à ceux qui ne se soucient pas, d’abord, sinon de s’en faire des amies, du moins, en stoïcien, de s’en accommoder. Ainsi, des lectures par lesquelles Bernard Sintès préludait aux concerts, seule la troisième, à Monfaucon donc, rendit justice au « cœur battant sous un manteau de plumes » que manifeste sa poésie du regard, de l’éloignement, voire de l’effacement (« Existe-t-il un verbe sans sujet ? », « Tout commence par la disparition »).

Si la flânerie indienne de Soleil d’effondrement, anticipait heureusement les cloches que Lemêtre a ramenées du sous-continent, par lesquelles on appelle à la cérémonie, celles qui se déchaînèrent à plusieurs reprises (à sept heures) au-dessus de sa tête déstabilisèrent le lecteur, le réduisant même au silence. C’est que l’espace mental de l’écriture n’est pas celui, physique, de la lecture. Écriture en cours met à jour, dans ses vers, le squelette de la grammaire. « Écrire m’est une guerre » y est-il dit, une guerre vaillamment menée au cours de cette campagne où, deux soirs durant, seul face à la loi adverse, dans le brouillard des résonances, surnageaient quelques phonèmes perdus que nous étions libres – pourtant frustrés – de recomposer à loisir.

C’était une raison de revenir, d’insister, jusqu’à ce qu’au milieu des bois de Monfaucon, le sens se révélât. Et quel sens : « Dans cent milliards d’années, tout aura disparu ». Mais nous aurons au moins vécu cela.
Philippe Alen
24/10/2020